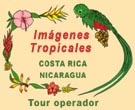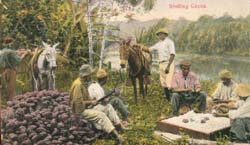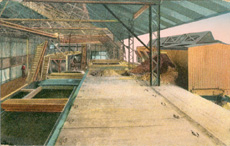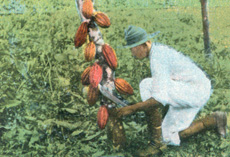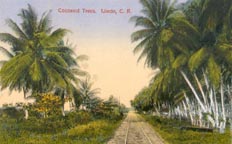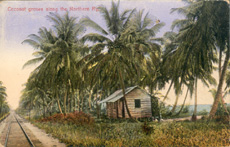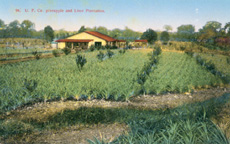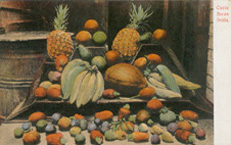LE
COSTA RICA d'AUTREFOIS
EN IMAGES
Cacao, noix de coco et ananas : l’histoire, la culture, les
hommes...
Le
cacao (mot provenant du nahuatl*)
est produit par une transformation de la « fève
» du cacaoyer, un arbre de taille moyenne (jusqu’à
3 mètres), originaire du Mexique et d’Amérique
centrale.
Les populations amérindiennes
(Mayas et Aztèques), utilisaient les fèves comme
monnaie d’échange mais aussi comme durée
alimentaire.
Au Costa Rica, l’usage des fèves de cacao comme
monnaie d’échange a été institutionnalisée
pour l’obtention des biens de consommation immédiate
comme les denrées alimentaires dans ce qui était
à l’époque « la province de Costa
Rica » en 1709. Il existait déjà dans
les communautés indiennes du fait de son importance
politico-religieuse.
Cependant seuls les communautés Miskito du
Nicaragua l’utilisaient réellement comme
monnaie au sens où nous l’entendons : pour l’acquisition
de biens.
Au moment de la période
coloniale l’idée a été reprise
par le pouvoir de la Couronne espagnole en raison de la très
faible circulation de monnaie d’or ou d’argent
et parce qu’il n’existait pas de sceau permettant
de frapper les monnaies dans l’isthme. |
|
Montée
au cocotier…
Carte Postale colorisée années 1930 |
Des tables de conversions cacao / monnaie
d’argent étaient utilisées, mais les
fluctuations constantes du « cours de la monnaie cacao
» et la fragilité de la fève de cacao
qui est une denrée périssable ont rendu assez
rapidement ce mode commercial difficile à maintenir.L’usage
du cacao comme monnaie d’échange a été
interdit à la fin du XVIIIº siècle. En
revanche, son utilisation pour le troc a continué
pendant une grande partie du XIXº siècle, en
raison de son importance alimentaire et commerciale.
La monétisation
de l’économie costaricienne s’est accélérée
avec le développement du café et l’apogée
économique qui a suivi à partir des années
1830, permettant l’utilisation chaque fois plus répandue
de la monnaie dans les échanges commerciaux et l’augmentation
du travail salarié.
Au Costa
Rica les ethnies
amérindiennes cultivaient les cacaoyers dans
les basses terres (là ou l’arbre pousse naturellement)
des côtes Pacifique (les Borucas
et les Guaymies) et Caraïbe (les Bribris).
De nos jours seules restent quelques plantations exploitées
notamment dans la région de Bribri. Les arbres ont
une maladie (un champignon) appelé « moniliasis
» qui a comme particularité de réduire
la production de « cabosse » (le fruit du cacaoyer),
en nécrosant ces dernières sans toutefois
affecter la qualité des rares fèves produites
…
* Nahuatl : groupe de langues amérindiennes
apparentées aux Aztèques. Le Nahuatl est encore
parlé de nos jours du Mexique à El salvador.
|
|
La
noix de coco est le fruit du cocotier (Cocos nucifera),
palmier originaires des îles du Pacifique et Indo-Malaisiennes,
acclimaté dans la plupart des régions tropicales.
Au Costa Rica son habitat est les côtes Atlantique et
Pacifique. Il est évoqué pour la première
fois au Costa Rica et au Panama en 1514 par Gonzalo Fernández
de Oviedo y Valdés.
Au 18 et 19e siècle au Costa Rica sa culture est attestée
(sans dates précises cependant), dans la deuxième
moitié du XIXº siècle, spécialement
avec 2 espèces : la « géante du Pacifique
» et la « géante de l’Atlantique
». Les parcelles dédiées à la culture
se développaient de façon désordonnées
et sans contrôle. Avec d’autres espèces
et de « cultivars* » introduits
dans les années 40, par la United Fruit Company dans
la région panaméenne de Bocas del Coco, le coco
s’est encore plus disséminé sur le territoire
costaricien.
Dans les années 80, la Corporation Bananière
National (CORBANA) a établi un programme d’hybridation
dans le but d’améliorer et systématiser
la culture, essentiellement dans la province caraïbe
de Limon.
Pendant très longtemps, les plantations de coco représentaient
une source supplémentaire de revenus pour les familles
vivant dans des régions éloignées, d’accès
difficile et d’où on ne pouvait sortir le produit
que par voie fluviale.
On continue aujourd’hui à en produire, mais surtout
pour en tirer des produits dérivés.
Les populations en récoltent les noix pour en extraire
le lait (de coco), et la chair pour s’en alimenter.
Sur le bord des routes, de nos jours de petits vendeurs proposent
aux automobilistes ces produits sous les deux formes, ainsi
que la noix entière.
L’huile extraite de la noix de coco est utilisée
dans les cosmétiques, le coprah (enveloppe fibreuse
de la noix), est utilisé dans l’industrie : tapis
brosse, balais, carpettes, revêtement de mobilier…De
nos jours la production de noix de coco est principalement
pour la consommation locale, mais on l’exporte également
aux Etats-Unis, en Espagne, en Italie, en Allemagne et aux
Pays Bas, sous forme râpée ou en composants d’huile
de bronzage. On l’utilise en aromathérapie.
*
Cultivar : variété plante obtenue en
culture, généralement par sélection,
pour ses qualités gustatives et de rendement.
|
|
L‘ananas*
est le fruit de la plante du même nom. Originaire du
Brésil, l’ananas (Ananas comosus), est
de la famille des Bromélias. Les principales zones
de culture au Costa Rica sont le centre nord, (région
de Puerto Viejo de Sarapiqui), le centre sud, (région
de San Isidro de El General), et Buenos Aires, dans la région
du Pacifique sud. Sa culture a été introduite
au Costa Rica dès les premiers temps de la conquête
espagnole. On la mentionne cultivée par les Indiens
Huetares de Tucurrique, au XVIº siècle (région
d’Orosi). Mais c’est à partir des années
30, avec l’implantation de cultivars (espèces
hybrides) sans épine et de meilleure saveur que la
production d’ananas a vraiment commencé à
se développer.
L’ananas est devenu le troisième poste économique
derrière le tourisme et la banane. Le Costa Rica est
le premier producteur en Amérique centrale, (avec 36
% des exportations totales), le Costa Rica est aussi le premier
fournisseur de l’Union Européenne et le seul
pays d’Amérique Latine à produire des
ananas bios. Le Costa Rica est le 7e exportateur mondial d’ananas.
* Ananas : en français on prononce
ou pas le « s » final.
Deux étymologies s’affrontent :
1° : le mot « ananas » viendrait
selon Wikipédia® de l’amérindien «
tupi-guarani » naná naná qui signifierait
« le parfum des parfums ».
2° : cette version ayant notre préférence.
« Ananas » est un nom d'origine amérindienne,
qui vient des Antilles, notamment d’Haïti. Selon
Moïse Bertoni (1), ce nom est guarani, peuple qui a vécu
sur l'île de Saint-Domingue. Ananas vient du guarani
ananá composé de : á = fruit + naná
= excellemment. Bertoni note que le terme abrégé
naná est plus répandu. La première citation
en français date de 1544 sous la forme : amanat (Cosmographie,
de Jean Fonteneau alias Jean Alfonse)
En 1555, une lettre de Nicola Durand de Villegagnon (2) :
« Oultre il y a deux sortes de fruicts merveilleusement
bons : l'un qu'ils appellent Nana »…
En 1578, Jean de Léry (2) écrit : « Semblablement
la figure du fruict qu'ils nomment Ananas »…
1
- Moïse Santiago Bertoni (1857-1929) savant
botaniste ethnologue et naturaliste d'origine Suisse italienne
qui fut surnommé, au Paraguay, le sage.
2 - Villegagnon (1510-1571) et Léry
(1536-1613) ont tenté de fonder une colonie
française nommée « France-Antarctique
» dans la baie de Rio de Janeiro.
Document
(texte) de 1807 à propos de l’ananas
|
|
|
|
Décorticage
des fèves de cacao
Carte postale colorisée années 1910 |
Séchage
des fèves de cacao au soleil
Carte postale colorisée années 1910 |
Séchage
des fèves de cacao par chaleur artificielle
Carte postale colorisée années 1910 |
|
|
|
Récolte
des cabosses de cacao
Carte postale colorisée années 1910 |
Cocotiers
- Limón, C.R.
Carte postale colorisée années 1910 |
Cocotiers
le long du chemin de fer du Nord*
Carte postale colorisée années 1930
|
*
Le « chemin de fer du Nord » est celui
de la côte atlantique. |
|
|
|
Costa
Rica, Puntarenas, Cocoteros* (et messieurs chics)
Carte postale colorisée années 1910 |
Cocoteros*
sur la côte Atlantique
Carte postale colorisée années 1900 |
Cocotiers
le long de la mer Caraïbe
Carte postale colorisée années 1930 |
| *
Cocoteros en espagnol, Cocos nucifera en latin, Cocotiers
en français. |
|
|
|
Plantation
d’ananas et de citrons
de la United Fruit Company*
Carte postale colorisée années 1910 |
Ananas
(récolte)
Carte postale sur papier photographique années 1940 |
Fruits
costariciens
Ananas, bananes, noix de coco, pommes cajou**, mangues…
Carte postale colorisée années 1910 |
*
United Fruit Company : grande société
nord-américaine, exploitant principalement la banane,
qui était associée en 1901 à l’administration
de la ligne
de chemin de fer San José – Puerto Limón.
** Pomme cajou (ou pomme de cajou) originaire
du Brésil, le « fruit » de l’anacardier
(Anacardium occidentale) est comestible (saveur acidulée
et âpre), son amande (le « vrai » fruit) est
elle aussi (et surtout) comestible, on la consomme soit grillée
et salée (à l’apéritif), soit nature
(notamment en pâtisserie). |
© Imagenes
Tropicales
Tous les documents anciens (ou non) : cartes postales, photographies,
gravures, cartes,… publiés sur ce site ont tous fait
l’objet d’une acquisition légale. Pour toute
reproduction et / ou utilisation commerciale ou non, merci d’en
demander l’autorisation à :
Plus de 5000 prises de vues sur le Costa Rica et l'Amérique
Latine à votre disposition. |
Mise
à jour : mai 2012 |
|
IMAGENES
TROPICALES S.A.
Apto 12 664 - 1000 - San José - Costa Rica (CA) Tél
: (506) 22 58 48 38 - E-mail : 
Imagenes
Tropicales l’agence de voyages francophone de
votre circuit, séjour, vacances, autotours…
Tourisme en Amérique centrale : Costa
Rica, Nicaragua, Panama, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador. |
|